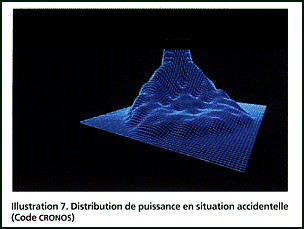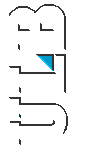
N'hésitez pas à contacter l'auteur à l'adresse suivante: tnkaoua@yahoo.fr
Le Calcul Scientifique: une discipline... multidisciplinaire...
...des physiciens...
...des numériciens...
...des informaticiens...
...des expérimentateurs...
Des codes de calcul, pour quoi faire ?
Conclusions
Les codes de calcul, qui permettent de simuler des phénomènes physiques, constituent des systèmes informatiques parmi les plus complexes. Cette complexité, mais aussi leur richesse, provient notamment du croisement de plusieurs disciplines, dénommé Calcul Scientifique, physique théorique, physique expérimentale, mathématiques et informatique.
Cette discipline dénommée Calcul Scientifique est présente dans de nombreux domaines de l'industrie
- maquettes numériques en avionique; crash tests virtuels en automobile;
- programme Simulation de la Direction des applications militaire (DAM);
- météorologie;
- pharmacie;
- physique des réacteurs nucléaires;
Dans cet article, on exposera les principes généraux du Calcul Scientifique, puis l'utilisation qui en est faite dans la conception et l'exploitation des réacteur; on donnera enfin quelques exemples de codes de calcul et leur domaine d'application.
Le Calcul
Scientifique: une discipline...
multidisciplinaire...
... des
physiciens...
La modélisation,
première étape du Calcul Scientifique, consiste à
concevoir une représentation d'un objet et de
phénomènes physiques qui s'y déroulent (illustrations 1 et 2). 
Les objets considérés et les phénomènes associés peuvent être aussi variés qu'un avion, l'air et leur interaction mutuelle, le combustible d'un réacteur et les réactions nucléaires qui s'y produisent, une molécule et ses propriétés chimiques.
Il existe pour un objet donné plusieurs échelles de description, de niveau de détails.
Il est clair
qu'un choix doit être fait entre le km et le micron !
Les phénomènes physiques sont représentés par des
équations dont la complexité peut aller de la simple
règle de trois à des systèmes couplés d'équations
aux dérivées partielles non linéaires (illustration
3).
Comme pour la géométrie, plusieurs modélisations de
précisions différentes peuvent décrire le même
phénomène: par exemple, pour évaluer une
foule, on peut soit
compter les individus un par un (précision maximale mais
réponse lente), soit évaluer sa surface et la
multiplier par une densité moyenne (précision plus
faible mais réponse rapide). L'un des rôles des
physiciens est de définir ces modèles et d'en évaluer
la précision.
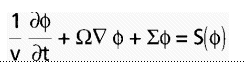
Illustration 3. Equation
simplifiée de la neutronique
Cette première étape de la modélisation est insuffisante pour aboutir à des calculs: il est impossible d'exhiber la solution des équations obtenues.
On fait appel aux mathématiques, en particulier à l'analyse numérique, qui permettent de transformer ces équations de manière " digérable " par des ordinateurs.
En
simplifiant à l'extrême, disons qu'une méthode
numérique va permettre de calculer une solution
approchée des équations en un nombre fini de points (illustration 4). 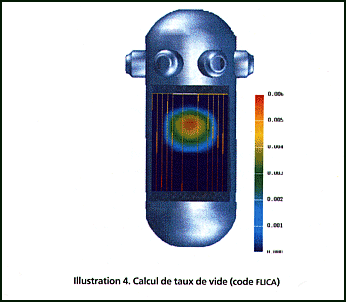
C'est le métier des numériciens de mettre au point ces méthodes dont le degré d'approximation doit être maîtrisé, contrôlé et potentiellement infini. Pour une équation donnée, il existe plusieurs méthodes, de précision et de temps de calcul différents.
Il faut à
présent programmer sur des ordinateurs parmi les plus
puissants (illustration 5),
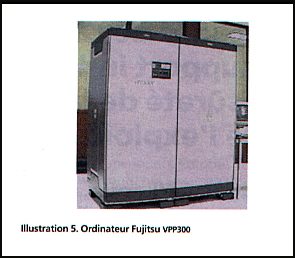
non seulement les méthodes numériques, mais la représentation des objets (cœur de réacteur, avion...) et les interfaces homme machine en entrée et en sortie. Naturellement, de nouvelles approximations sont introduites, puisque les ordinateurs ne travaillent qu'avec un nombre fini de décimales et que la simple addition de deux nombres n'est faite qu'à la précision de la machine près! On est arrivé au produit livrable: le code de calcul. L'augmentation régulière de la puissance des ordinateurs, jamais démentie depuis 50 ans, à travers les architectures vectorielles, superscalaires, massivement parallèles, et dernièrement Multi processeur symétrique (SMP) a permis, au même titre que les autres disciplines, un progrès continu de la simulation numérique.
Il
est important de noter que la validation du système
informatique ainsi conçu (la vérification que ce qui
est programmé est conforme à ce qui a été prévu) va
bien au delà de la recherche de bugs (erreurs de
programmation). La mise en évidence de biais peut en
effet provenir de chacune des phases précédentes:
modélisation, méthode numérique,
erreurs d'arrondis.
Le travail est donc loin d'être achevé: il faut valider
et qualifier ce code de calcul, étape tout aussi
importante que les précédentes. Par des
expérimentations globales ou analytiques (illustration 6), on valide la capacité
du code à restituer les phénomènes physiques et on
détermine le domaine de validité du code.
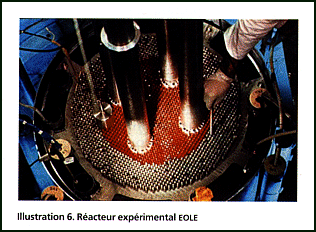 Les codes de calcul utilisent des
données physiques de base (sections efficaces,
équations d'état, lois de comportement, corrélations,
etc.) qui sont aussi l'objet de modélisations,
d'expérimentations et d'une qualification, et dont la
pertinence est tout aussi capitale.
Les codes de calcul utilisent des
données physiques de base (sections efficaces,
équations d'état, lois de comportement, corrélations,
etc.) qui sont aussi l'objet de modélisations,
d'expérimentations et d'une qualification, et dont la
pertinence est tout aussi capitale.
Des codes de calcul, pour quoi faire ?
Modéliser un phénomène et faire un calcul requièrent donc le choix d'un niveau de représentation pour chaque maillon de cette chaîne: géométrie, modèle physique, équations, méthodes numériques, données de base et ordinateurs. Il est aussi essentiel de maîtriser le domaine de validité du code.
Passer un calcul n'est pas un acte si anodin qu'il en a l'air ! L'utilisateur, sans être un spécialiste de tous les domaines précédents, doit néanmoins les maîtriser suffisamment pour pouvoir porter un regard critique sur les résultats dont il va se servir.., dans le monde réel! Les codes de calcul ainsi développés sont des outils puissants. Ils sont devenus partie intégrante des méthodes de conception et d'exploitation des réacteurs, jusqu'au démantèlement. Il sont utilisés par tous les acteurs du nucléaire dans le monde: les concepteurs de réacteurs et de combustibles, les exploitants, les organismes de radioprotection, les autorités de sûreté, les organismes de recherche. Ils ont un rôle à jouer à chaque étape de la défense en profondeur de nos installations nucléaires: lors de la conception, les codes servent à asseoir le bien-fondé des concepts retenus pour s'assurer d'un dimensionnement correct, aussi bien dans les situations normales que perturbées; ils aident à définir les défenses en cas de défaillance du système: barrières de confinement, terme source, recombinaison d'hydrogène...; pendant le suivi du fonctionnement, ils participent à la détermination de l'état du système, à l'anticipation de son évolution et à la détection d'anomalies ou de défaillances; enfin, dans le domaine des études d'accidents, ils aident à la mise au point des moyens permettant la limitation des conséquences d'une défaillance: coefficients de transfert et de dilution du terme source, calculs d'activité dans des zones données...
Exemples, domaines d'utilisation Les codes de protection contre les rayonnements de toute nature (neutrons, gamma, particules chargées) permettent de calculer les débits de dose à longue distance. Dans ce domaine, le CEA a développé, avec le soutien des partenaires EDF et Framatome, le système de codes PROMETHEE, basé sur les codes TRIPOLI (Monte-Carlo) MERCURE (atténuation) et SN1D (ordonnées discrètes), ainsi que DARWlN/PEPIN2 pour la détermination des sources de rayonnements issues des phénomènes de radioactivité. Ces codes sont largement utilisés dans l'industrie nucléaire française. Ils permettent de dimensionner les systèmes de protection radiologique des installations ou des conteneurs de transport de matière nucléaire. La qualification de ces codes repose pour une part importante sur des expériences repères (benchmarks) qui ont été menées dans différents laboratoires à travers le monde, et dont les résultats sont mis à la disposition de la communauté internationale. Elle s'appuie également sur le retour d'expérience du parc nucléaire français, comme l'illustre l'analyse comparative des résultats issus des codes de propagation des rayonnements et des mesures dosimétriques effectuées dans le cadre du programme de surveillance des cuves des réacteurs à eau sous pression.
En ce qui concerne le calcul des cœurs de réacteurs à eau, soutenu par EDF et Framatome, le CEA a réalisé un système de codes, SAPHYR, basé sur APOLLO 2 pour la neutronique microscopique des assemblages, CRONOS 2 pour la neutronique du cœur, FI. ICA 4 pour la thermohydraulique du cœur, et PEPIN 2 pour l'évolution isotopique. Ces codes sont couplés (on calcule simultanément la neutronique, l'évolution isotopique et la thermohydraulique du cœur), ce qui constitue l'une des modélisations les plus avancées qui existent aujourd'hui. L'installation AGATE qui mesure les composantes axiales et transverses d'un fluide, ainsi que GRAZlELLA qui permet d'étudier la thermique des assemblages, participent à la qualification de FLICA. En ce qui concerne la neutronique, la qualification d'APOLLO s'effectue sur les réacteurs expérimentaux du CEA (MINERVE, EOLE...) où sont reconstitués des parties de réacteurs de puissance, et dans lesquels différentes mesures importantes pour le fonctionnement du réacteur (réactivité par exemple) sont effectuées.
Pour la neutronique des réacteurs rapides, le CEA a développé le système de code ERANOS dont la qualification s'est effectuée sur le réacteur expérimental Masurca.
Dans le domaine de la mécanique (chute d'objets sur des tuyauterles, perforation de béton, enceintes...) le code CASTEM 2000 permet de traiter des problèmes d'élasticité linéaire en statique et dynamique, des problèmes non linéaires (élasto-visco-plasticité), la rupture... L'installation TAMARIS (tables vibrantes) et RESEDA (essais dynamiques et statiques) participent à la qualification de CASTEM.
Le comportement thermo-mécanique des combustibles est modélisé au sein du code METEORE qui calcule notamment les interactions combustible-gaine.
Enfin, dans le
domaine de la sûreté, le code CATHARE, développé par
le CEA pour EDF, Framatome et IPSN, traite de la
thermohydraulique à l'échelle du système. Ce code
largement utilisé à travers le monde permet de mener à
bien les évaluations de sûreté des réacteurs à eau
pressurisée. Le programme de validation 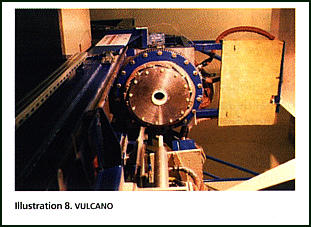 expérimentale de CATHARE a été
systématique et progressif, depuis les modèles
élémentaires, jusqu'au retour d'expérience sur les
réacteurs, français et étrangers. Parmi les nombreux
moyens expérimentaux utilisés pour cette validation,
citons la célèbre boucle système BETHSY, et les
installations plus analytiques OMEGA, MHYRESA et
COTURNE.
expérimentale de CATHARE a été
systématique et progressif, depuis les modèles
élémentaires, jusqu'au retour d'expérience sur les
réacteurs, français et étrangers. Parmi les nombreux
moyens expérimentaux utilisés pour cette validation,
citons la célèbre boucle système BETHSY, et les
installations plus analytiques OMEGA, MHYRESA et
COTURNE.
Les codes TOLBIAC
et THEMA calculent la convection naturelle, la
physico-chimie et l'étalement du corium, en cas
d'accident grave (certes très improbable) conduisant à
la fusion du cœur. Le système expérimental CORINE
simule l'étalement et la solidification de matériaux
dans des conditions expérimentales non contraignantes,
mais transposables. VULCANO permet le même type
d'expériences dans des conditions réalistes de
matériaux et température.
Le Calcul Scientifique est clairement un outil au service de l'industrie et de la recherche. Il est remarquable de noter le rôle fédérateur que joue cette discipline à travers la diversité des sciences et techniques du nucléaire et des acteurs en présence: industriels, exploitants, chercheurs, théoriciens, expérimentateurs. Le Calcul Scientifique autorise une réelle synergie dirigée vers la résolution d'un problème concret d'intérêt commun et se situe à l'intersection de plusieurs points d'intérêt : besoin de résultats de l'industriel, besoin de savoir des théoriciens, besoin d'avancer des chercheurs. Le lien qu'il assure entre monde réel et théories est absolument essentiel.
Le
rôle joué par le Calcul Scientifique a toutes les
raisons de s'amplifier dans les années à venir: il est
à la fois source de progrès technique et économique,
et réceptacle des progrès accomplis dans l'ensemble des
autres disciplines scientifiques.